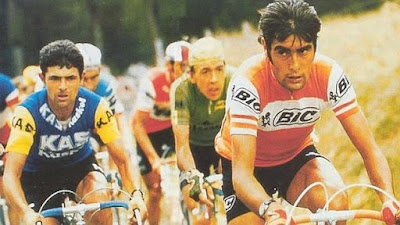article précédent : "Bien sot est le mouton qui se confesse au loup" - proverbe allemand
“Gomme élastique :
Est faite avec le scrotum de cheval.”
Gustave Flaubert,
Le Dictionnaire des idées reçues ou Catalogue des opinions chics, 1913
 |
| Gustave Flaubert, 12 décembre 1821 - 8 mai 1880 |
 |
| mérou |
Bonjour à toutes et tous !
Plusieurs lectrices
- oui, curieusement, seules des lectrices ont fait le lien... -se demandaient très intelligemment
- faut-il vraiment le préciser ? Des dames, et qui plus est fidèles lectrices d'un blog aussi improbable ... -s'il fallait voir un lien entre le latin scortum, “peau”, et le latin... scrōtum, “peau”, aussi, mais plutôt de euh...
reprenons:
... et le latin scrōtum, désignant l'enveloppe cutanée des testicules.
 |
| "Puissiez-vous vivre aussi longtemps que votre corps tout entier ne ressemble plus qu'à un scrotum" |
Ah ! Une aussi bonne question attend une réponse claire et simple.
Hélas...
Je ne serai en mesure de vous la donner, cette réponse directe et limpide...
Je ne pourrai que vous soumettre des propositions de réponses.
Pour l'American Heritage Dictionary - et donc Calvert Watkins -, le Webster's et Winfred P. Lehmann, la réponse est ... OUI.
Oui, le latin scrōtum dérive bien de notre formidable *(s)ker-.
Ce qui impliquerait une métathèse
(une permutation phonétique, pour les gens normaux, ceux qui ne sont pas lecteurs assidus de ce blog),ainsi qu'une spécialisation du sens premier de scortum, “peau”.
J'eusse tant aimé en rester là...
Mais bon, comme disait mon compatriote Brel
(si vous ne voyez pas qui c'est, pensez à Stromae, mais en nettement moins bien, sans visage ni démarche de clown triste, sans marketing, sans marque de vêtements),la vie ne fait pas de cadeaux.
Ce que je poursuivrais par...- kadooutai aurait merveilleusement condensé en un seul mot fort et surtout vrai le grand Stromae -
Et nom de dieu !
Si Orly est triste le dimanche
Avec ou sans Bécaud,
Le dimanche (indo-européen) peut l'être aussi,
Avec ou sans -... euh la rime... Aah... - Blondieau.
Eh oui.
Pour l'heure, et pour rester dans le domaine des certitudes, sachez que les anatomistes français ont emprunté le mot vers 1540, pour en faire le français ... scrotum.
Ce qui ne devrait pas, au demeurant, vous surprendre outre mesure.
Et qu'aussi, on peut rapprocher scrōtum du latin scrautum, qui désignait le carquois, cet autre étui, destiné lui à contenir non pas des douilles mais des flèches, et toujours, du moins à l'origine, fait de ... peau.
 |
| long carquois romain (source) |
racine indo-européenne *(s)ker-, “couper, découper”
⇓
forme *skort-o-, “coupe, coupure...”
⇓
proto-italique *skort-o-
⇓
latin scortum, “peau”
⇓
métathèse et spécialisation du sens
⇓
latin scrōtum, “enveloppe cutanée des testicules” (et aussi “scrautum”, carquois)
⇓
emprunt savant (circa 1540)
⇓
français scrotum

Et hop !
Mais voilà, pour d'autres linguistes, il n'est vraiment pas certain que scrōtum et scrautum proviennent de notre *(s)ker-.
Eh !
Alain Rey penche, lui, pour une filiation de scrōtum à partir d'une racine indo-européenne, certes, mais qu'il ne nomme curieusement pas...
Il précise cependant que le mot latin signifie d'abord “ce qui garnit”.
Et c'est pour moi un grand mystère...
Je pourrais supposer qu'il déduit ce sens original de la sémantique de la racine indo-européenne qu'il voit à la source de scrōtum ?
Mais, voyez-vous, j'ai beau chercher, je ne retrouve aucune racine qui, de forme *(s)k?-, évoquerait la notion de garnir.
De près ou de loin.
Le mystère s'épaissit...
Et, je vous le dis tout de suite - je n'aurai pas de réponse à y apporter.
Sauf peut-être la boisson ? Mais non, je n'oserais imaginer Alain Rey boire plus que de raison.


Donc, voilà une piste qui s'arrête...
Ou alors...
- mais dans ce cas, il vaudrait peut-être mieux ne pas écarter l'hypothèse boisson trop vite -Oui, on retrouve bien un proto-germanique *skraudan-, “couper, déchiqueter”, peut-être dérivé d'une racine indo-européenne tardive et de même sens, *skróudʰ-e- qui, en
- OUI OUI OUIIIIII -vieux norois, donnera skrúð, dont une des acceptions sera “ornement, chose précieuse”...
(Parce qu'il s'agissait d'un vêtement de peau, d'une pièce de cuir particulièrement travaillée?)
Mais convenez-en, cela semble vraiment tiré par les cheveux.
Et nous sommes là à des lieues du latin scrōtum...
racine indo-européenne skróudʰ-e-, “couper, déchiqueter”
⇓
peut-être
⇓
proto-germanique *skraudan-, “couper, déchiqueter”
⇓
vieux norois skrúð, (notamment) “ornement, chose précieuse”
Une autre étymologie nous est encore donnée par Michiel de Vaan.
Enfin, non.
Justement.
Pour de Vaan, qui examine
dans son Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languagesle latin scrūta, -ōrum, “bric-à-brac, vieilleries, pacotille...”
(ou pour Ernout et Meillet, “hardes, défroques, friperies”),scrautum et scrōtum pourraient en dériver (de scrūta, -ōrum, enfin ! Allez, reprenez un café).
“Pourraient” en dériver.
Car même si formellement, on pourrait les associer à scrūta, sémantiquement, c'est une autre histoire...
latin scrūta, -ōrum, “vieilleries, hardes, défroques, friperies...”
⇓
peut-être
⇓
latins scrautum et scrōtum
De mon enquête ressort encore un élément dont j'aimerais vous faire part...
Pour Guus Kroonen et son Etymological Dictionary of Proto-Germanic,
le latin scrūta, -ōrum, “bric-à-brac, vieilleries, pacotille...” pourrait
(“pourrait”)n'être qu'un emprunt au germanique ... *skraudan-, “couper, déchiqueter” (ou à un de ses descendants) !!
racine indo-européenne skróudʰ-e-, “couper, déchiqueter”
⇓
peut-être
⇓
proto-germanique *skraudan-, “couper, déchiqueter”
⇓
(...)
⇓
peut-être emprunt
⇓
latin scrūta, -ōrum, “vieilleries, hardes, défroques, friperies...”
⇓
peut-être
⇓
latins scrautum et scrōtum
Alors, que tirer de tout cela ?
Ben, que scrōtum pourrait dériver de scrūta, -ōrum,
lui-même peut-être simple emprunt au germanique *skraudan-,
construit peut-être sur une racine indo-européenne tardive, *skróudʰ-e-, “couper, déchiqueter”.
(C'est d'elle, d'ailleurs, que proviendra, par le vieil anglais scrēad, l'anglais shred, “déchiqueter”.)
racine indo-européenne skróudʰ-e-, “couper, déchiqueter”
⇓
peut-être
⇓
proto-germanique *skraudan-, “couper, déchiqueter”
⇓
vieil anglais scrēad
vieil anglais scrēad
⇓
anglais shred, “déchiqueter”
Ou qu'alors, comme d'autres - et non des moindres - le pensent, scrōtum serait tout simplement dérivé de *(s)ker-.
À vous de choisir !
Choisir, faire son choix, comme lors d'un scrutin...
Scrutin, réfection (attestée en 1465) de crutine, crestine, emprunté au bas latin scrutinium, “action de fouiller”, pour se spécialiser dans le vocabulaire ecclésiastique pour désigner l'examen des opinions.
Vous l'aurez compris, scrutinium dérivait du latin classique scrūta, -ōrum.
Précisément par le verbe scrūtārī, “fouiller, chercher dans les hardes”.
latin scrūta, -ōrum, “vieilleries, hardes, défroques, friperies...”
⇓
latin scrūtārī, “fouiller, chercher dans les hardes”
⇓
bas latin scrutinium, “action de fouiller”
⇓
spécialisation
⇓
“examen des opinions”
⇓
français crutine, crestine
⇓
réfection
⇓
scrutin
C'est une image forte, ne trouvez-vous pas ?
Lors d'un scrutin, étymologiquement, on vous fait choisir parmi des hardes, de la pacotille, toutes choses dont on veut se débarrasser.
Vous voyez ces charmants petits insectes qu'on appelle des bousiers?
Ben, c'est un peu leur rôle qu'on vous demande d'endosser, non, lors d'un scrutin ?
Oui, c'est bien ça, en fouillant la m.
Je trouve vraiment cette image très, très, forte...
Et à voir tous ces corrompus, ces incompétents et ces médiocres qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts parmi lesquels nous devons faire un choix en Belgique à chaque élection fédérale ou régionale, je puis affirmer que nous pouvons être fiers, nous Belges, d'avoir pu conserver à scrutin son étymologie première.
Allez, on se retrouve dimanche prochain, le dernier dimanche de cette année, pour la suite des aventures de l'incroyable *(s)ker-.
Je vous souhaite, à toutes et tous,
un merveilleux Noël.
un merveilleux Noël.
Fêtons donc le retour de la lumière, l'avènement de l'amour et de la fraternité entre tous les hommes.
Je sais.
Rêvons un peu.
Frédéric
PS: dans ces articles, les passages de texte en bleu, vous l'aurez compris, traitent d'éléments de linguistique.
******************************************
Attention,
ne vous laissez pas abuser par son nom:
on peut lire le dimanche indo-européen
CHAQUE JOUR de la semaine.
(Mais de toute façon,
avec le dimanche indo-européen,
c’est TOUS LES JOURS dimanche…)
******************************************
Et pour nous quitter,
Comme la semaine dernière, du Purcell...
Cette fois, tiré de Come Ye Sons of Art, Z.323, 1694
le célèbre
Sound the Trumpet,
mais dans une version particulière...
À l'origine, duo pour hautes-contre,
il est ici interprété par l'excellent haute-contre Iestyn Davies
mais aussi par la plus que talentueuse trompettiste Alison Balsom
******************************************
Vous voulez être sûrs (sûrs, mais vraiment sûrs) de lire chaque article du dimanche indo-européen dès sa parution ? Hein, Hein ? Vous pouvez par exemple...
- vous abonner par mail, en cliquant ici, en tapant votre adresse email et en cliquant sur “souscrire”. ET EN CONFIRMANT le lien qui vous arrivera par mail dans les 5 secs, et vraisemblablement parmi vos SPAMS (“indésirables”), ou
- liker la page Facebook du dimanche indo-européen: https://www.facebook.com/indoeuropeen/
******************************************
article suivant : A Binche, il y a des acharnés du carnaval