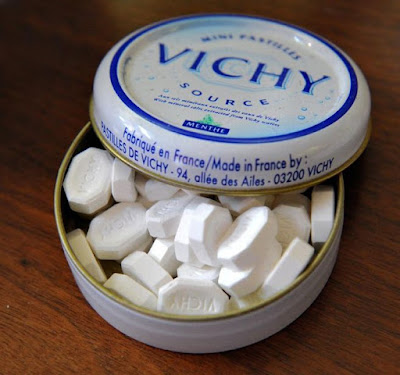“Quelques filons de pegmatite, roche dont la décomposition fournit le kaolin, employé dans la fabrication des porcelaines, sillonnent çà et là ces masses granitiques, parsemées en outre de quelques rognons de quarz et de veines de mica.”
Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau,
L'Archipel de Chausey, souvenirs d'un Naturaliste,
in La "Revue des Deux Mondes", tome 30, 1842
Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau,
L'Archipel de Chausey, souvenirs d'un Naturaliste,
in La "Revue des Deux Mondes", tome 30, 1842
 |
| Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau, ou, pour les intimes, Armand de Quatrefages, biologiste, zoologiste et anthropologue français, 6 février 1810 - 12 janvier 1892 |
Bonjour à toutes et tous !
Nous le savons déjà, la racine indo-européenne *peh₂ǵ- nous a donné notamment ...
- les anglais fang, “croc”, peg, “patère...” et travel, “voyage”,
- l'allemand Fuge, “jointure”, et puis, ben voyons,
- nos français pacte, paix, pays, (la) page, païen, paysage, propager, provin, propagande, pieu, pal, travail, travelling, balise, palissade, palonnier, pale, palette, paluche et pelle !
Mais oui, oh, tout est là :
troïka, sitar et trèfle,
Guerre et Paix. Et saucisse,
retour au pays,C'était il y a très, très, très longtemps ...,j'l'aime bien, mais ch'peux plus l'voir en peinture,peut-on considérer les années 20 comme de la propagande pro-vin,
pālus et pāla sont en bateau...,
À Lisbonne, on munissait les Latécoère de l'Aéropostale de balises en carton, et puis
le mécano lançait l'hélice du vieux coucou à la paluche.
(attention cependant : je ne recommande aucunement la lecture de ce dernier article à toute personne fragile des intestins et/ou à la digestion difficile ; au moins une lectrice en a trouvé le texte indigeste (je la cite :
“Dommage , un peu indigeste le texte ?”), et je ne tiens vraiment pas à avoir vos soucis gastriques sur la conscience.)
Amis lecteurs, je profite d'un moment de répit entre deux de vos crampes d'estomac
pour vous l'avouer : nous sommes presque arrivés à la fin de notre étude de l'époustouflante racine indo-européenne *peh₂ǵ-, “attacher”.
Encore un article après celui-ci - si je compte bien -, et nous devrons rendre la belle *peh₂ǵ-, “attacher”, à sa lointaine préhistoire, à sa dure vie dans la plaine pontique.
Oui bon, je sais, ma prose est assez indigeste, mais sachez que je fais référence ici au berceau du proto-indo-européen, dont je parle par ailleurs dans la rubrique Le pourquoi et le comment, créée - mais visiblement en vain -, pour mettre en contexte ce blog et chacun de ses articles, et les rendre ainsi un peu plus ... digestes.
Tentons donc de terminer en beauté cette longue série d'articles.
Avec, tout d'abord, une acception du latin pango que nous avions omise jusqu'ici...
Nous en avons parlé : pango pouvait signifier “enfoncer, ficher, planter, ensemencer”, voire “conclure”.
Mais oui, relisez Guerre et Paix. Et saucisse !
Ça va, jusqu'ici ? Je vous laisse absorber quelques petites gorgées de Vichy Célestins (mais surtout, pas trop fraîche), par précaution, et on continue...
C'est en toute vraisemblance à partir du sens d'enfoncer que possédait pango, que le latin construisit l'acception que je vous présente maintenant :
Tracer des lettres (sur la cire), fixer dans la cire, écrire,
d'où aussi composer,
d'où encore dire, chanter.
C'est ainsi que dans l'un des douze volumes de son imposant De re rustica, ce bon Lucius Iunius Moderatus Columella nous dit, à propos de la lettre b, que...
littera proxima primae pangitur in cera docti mucrone magistri,
la lettre la plus proche de (après) la première est tracée sur la cire par la pointe (le stylet) du maître savant.
 |
| Lucius Iunius Moderatus Columella, dit Columelle, agronome romain de la 1ère moitié du 1er siècle, né à Gadès (Cadix) |
Et l'expression latine pangere egregia opera pouvait se comprendre comme célébrer, chanter, les hauts faits.
Chante, ô ma langue ...
Ce n'est pas moi qui le dis, mais bien Saint Thomas d'Aquin
- excusez du peu -,
 |
| Thomas d'Aquin 1224 ou 1225 - 7 mars 1274 |
dans l'un des plus beaux hymnes grégoriens qu'il ait jamais composés (pour l’office des vêpres du Jeudi Saint, soyons fou), le plain-chant Pange Lingua, “Chante, (ma) langue”, dont le premier vers, dont on a tiré le titre
- je le précise par crainte de passer pour indigeste -
commence par notre pango à l'impératif :
Pange lingua gloriósi corpóris mystérium,
Chante, ô ma langue, le mystère de ce corps très glorieux
Nous avions évoqué, au nombre des dérivés de la charmante *peh₂ǵ-
- dites, ça va ? Pas trop de gargouillis, pas de ballonnements ? -,au moment de Guerre et Paix. Et saucisse,
le verbe grec ancien πήγνυμι, pêgnymi, “ficher, planter, fixer”.
Oui ?
Eh bien, il ne s'agit pas que du seul mot grec ancien légué par notre vrombissante *peh₂ǵ-.
Eh non ! Car il y a aussi...
À noter (ou pas ?) que les Romains, qui à leur navrante habitude pompaient le grec à tire-larigot, ont subtilement calqué leur pēgma, pēgmatis latin sur le beau πῆγμᾰ grec.
Ne nous en plaignons pas outre mesure, car nous devons au latin pēgma le français... pegmatite, emprunt savant du vocabulaire géologique créé il n'y a pas si longtemps (en 1811), pour désigner cet assemblage, ce conglomérat que représente une roche magmatique à grands cristaux (pouvant, par ailleurs, recéler des éléments rares, comme le lithium ou l'uranium).
 |
| en voilà une pegmatite qu'elle est belle (expression particulièrment indigeste) |
Quant au composé grec ancien σκηνοπηγία, skênopêgía, créé sur σκηνή, skênê, “tente” et πήγνυμι, pêgnumi, et qui donc, littéralement, signifierait action de fixer, d'établir une tente, il était le nom que les Grecs donnaient à la fête juive des Tabernacles
 |
| montage d'une tente |
 |
| tente montée pour la fête des Tabernacles |
Le latin, forcément, reprit le mot,
pour en faire scenopegia, que nous reprendrons nous-mêmes bien plus tard, penauds, sous le calque scénopégie.
Vous voyez le lien ? Le gel coagule, “fixe” les choses, il les fige, les cristallise.
 |
| givre |
Oh, et il y a encore πάγη, págē, substantif qui désignait, lui, le piège, le collet.
Mais oui, un triste engin qui servait, étymologiquement, à fixer, maintenir.
Enfin, je vous livrerai l'adverbe ...
ἅπαξ , hápax, “une fois, une seule fois...”, que Beekes décompose en
- ἁ-, dérivé de l'indo-européen *sm̥-, timbre zéro de la sémillante *sem-, “un”, dont nous avions parlé il y a trèèèèss longtemps, fin juin 2013, précisément ici :
C'est simple: trop souvent ensemble, on finit par être assimilé l'un à l'autre...
suivi de ...
- -πᾰξ, que Beekes relie à πήγνυμι, pêgnymi.
Si Robert Beekes, dans son ô combien admirable Etymological Dictionary of Greek,
n'est pas très disert sur la raison pour laquelle resurgit ici notre douce *peh₂ǵ-, il lui attribue pour l'occasion le sens de ferme, solide.
On peut dès lors peut-être y voir l'idée d'un un (1) compacté, solidifié pour marquer le fait qu'il n'y en a pas d'autres...
Si vous avez une hypothèse plus intelligente à proposer, je suis preneur !
Toujours pas de reflux acide, de brûlures d'estomac ?
Aïe, ça commence !?
Alors, mieux vaut s'arrêter ici.
Nous poursuivrons et en terminerons bientôt avec les dérivés de notre délicieuse *peh₂ǵ-, notamment dans les langues germaniques, mais aussi dans l'indigeste khotanais
- si, si, j'insiste ! -,
et enfin, enfin, en avestique, et en sanskrit ...
Je vous souhaite un excellent dimanche, et une très belle semaine.
À... dimanche prochain !
(pensez bien à vous munir de votre bouteille de Vichy Célestins)
À... dimanche prochain !
(pensez bien à vous munir de votre bouteille de Vichy Célestins)
******************************************
Attention,
ne vous laissez pas abuser par son nom :
on peut lire le dimanche indo-européen
CHAQUE JOUR de la semaine.
(Mais de toute façon,
avec le dimanche indo-européen,
c’est TOUS LES JOURS dimanche…)
******************************************
Et pour nous quitter,
un éclairage en demi-teintes du sublime Ode an die Freude,
composé par Beethoven sur un poème de Friedrich von Schiller.
Ce qui vient de se passer outre-Manche,
ce triomphe de la bêtise et de l'inculture, du nationalisme et du populisme,
mêlé de relents d'extrême droite,
cette débâcle de l'intelligence et de l'humanisme,
ça,
c'est à moi que ça procure des crampes d'estomac.
******************************************
Vous voulez être sûrs (sûrs, mais vraiment sûrs) de lire chaque article du dimanche indo-européen dès sa parution ? Hein, Hein ? Vous pouvez par exemple...
- vous abonner par mail, en cliquant ici, en tapant votre adresse email et en cliquant sur “souscrire”. ET EN CONFIRMANT le lien qui vous arrivera par mail dans les 5 secs, et vraisemblablement parmi vos SPAMS (“indésirables”), ou
- liker la page Facebook du dimanche indo-européen: https://www.facebook.com/indoeuropeen/
******************************************
article suivant: gwlad heb iaith, gwlad heb genedl